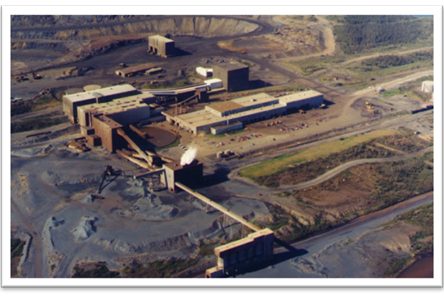On voit les choses différemment au Cégep de Sept-Îles. Depuis janvier, les élèves… et les profs apprivoisent la nouvelle classe active où l’enseignement magistral et traditionnel perd ses repères. Jusqu’à présent, ceux qui y goûtent y prennent goût!
C’est évident que la classe d’apprentissage actif n’a rien d’une classe conventionnelle. Oubliez les pupitres et le tableau vert… Le professeur n’a même pas de bureau. Ici, on se concerte, on partage autour de tables de travail arrondies aux couleurs vives. Un tableau blanc par équipe, un autre interactif. Et voilà le mélange idéal pour le bourdonnement d’idées.
«L’ambiance en vient à ressembler même à une ruche d’abeilles», lance l’enseignante de biologie, Patricia Saindon. «Le fait que les tables ne soient pas grandes, c’est propice à la discussion», renchérit sa collègue de humanities, anglais et littérature, Sharon Coyle. «Avec vingt élèves dans la classe, c’était bruyant. J’avais peur que ce soit trop, mais non, les jeunes sont concentrés, ils n’entendent pas les autres».
C’est Mme Coyle, qui avait vu ce type de classes dans des collèges de Montréal, qui a amené l’idée à Sept-Îles. «Ça vient créer un endroit propice à l’apprentissage», assure-t-elle. Mais, l’organisation des lieux force également le professeur à revoir ses façons de faire. «Tu ne peux pas faire de l’enseignement magistral pendant trois heures de temps», illustre la directrice adjointe des études, Marie-Eve Vaillancourt.
«Ça ne passera pas parce que l’organisation physique est en ilots, ça encourage l’apprentissage actif. Ce sont les étudiants qui travaillent», poursuit-elle. «Il faut vraiment que tu penses à la problématique que tu veux aborder en classe, il faut que ce soit clair avant», ajoute Mme Saindon.
«Développer la piqûre»
Depuis le début de l’année, les professeurs de différents programmes font, comme Patricia Saindon et Sharon Coyle, des essais dans la nouvelle classe active. Et le résultat est surprenant, selon elles. «Ils (les étudiants) utilisent leurs connaissances acquises au préalable, mais il y a toutes sortes d’idées, de façon de travailler et ils sont capables de solutionner les problèmes», se réjouit Mme Saindon.
«Par rapport à l’enseignement magistral, la différence c’est que ce sont les élèves qui se l’expliquent entre eux», ajoute la professeure de biologie, qui entend trouver l’équilibre entre l’enseignement plus traditionnel et l’utilisation de la classe active. «Plus les élèves y prennent goût, plus j’ai des idées pour l’utiliser. J’ai une activité que je faisais en labo, mais là, je vais la faire ici la semaine prochaine», dit-elle.
Selon le Cégep, certains professeurs songeraient même à donner la totalité de leur matière dans les murs de la nouvelle classe. «L’idée était de développer la piqûre chez les enseignants», confie Mme Vaillancourt. «Parce que ça change les paradigmes de l’enseignement». Un sondage effectué auprès du corps professoral a d’ailleurs permis de constater que plusieurs profs s’adonnaient déjà à l’apprentissage actif que ce soit par la classe inversée (théorie à la maison, pratique en classe), l’approche par projets ou les études de cas.
Une deuxième à venir
Le collège a déjà l’idée d’implanter une deuxième classe du genre, plus grande et entièrement équipée. Celle en place est qualifiée de low-tech parce qu’elle ne dispose que d’un tableau interactif. «L’objectif (pour la seconde classe) c’est que chaque table ait son tableau interactif par exemple, il y a aussi l’idée d’avoir des iPad sur les tables», illustre Mme Vaillancourt. Le Cégep a aussi introduit le Smart Kapp, un autre genre de tableau, qui permet le partage de contenu en temps réel.
Mais tant les professeurs que les étudiants voient aussi des avantages à avoir une classe active sans trop d’équipements. «Ça revient plus à la pédagogie et non à la technologie», indique Mme Coyle. «Il y a des profs qui ne sont pas trop à l’aise avec la technologie». «Et les étudiants aiment ça aussi», renchérit Mme Saindon. «Ils sont toujours avec les écrans, là ils retrouvent le crayon, c’est social».